« Une douleur liée à l’identité, qui ne peut être traitée que par l’art »
Entretien avec Steven Cohen autour de Sphinctérographie
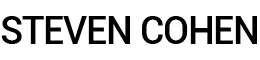

Entretien avec Steven Cohen autour de Sphinctérographie
Barbara Turquier : Quel a été le point de départ de Sphincterography ?
Steven Cohen : Le point de départ de ce spectacle est une douleur liée à l’identité, qui ne peut être traitée que par l’art. à moins que cela soit Assuérus dans Le Livre d’Esther, et la longue tradition du Juif errant ? Ou la prise de conscience que j’étais un queer enfermé dans le corps d’un gay ?
Je ne sais pas exactement quand ce spectacle a commencé et où il va finir… Peut-être avec l’exil de mes grands-parents juifs qui ont fui les persécutions en Europe… Peut-être va-t-il finir à la Préfecture ?
Pourriez-vous décrire le projet ? Qu’est-ce que les spectateurs pourront voir ? D’après ce que j’ai pu lire, des films de vos performances passées sont diffusés : comment les avez-vous sélectionnés, utilisés et présentés ? Est-ce que vous intégrez également des travaux plus récents ?
Un des plaisirs inhérents au fait de changer de catégorie (ce spectacle n’est pas classé dans la catégorie « danse » du Festival d’Automne, comme mes quatre œuvres précédentes, mais dans la catégorie « art visuel / performance »), c’est la liberté de jouer avec les attentes du public. Donc, je ne me sens pas obligé de présenter une avant-première de façon conventionnelle… Une performance fonctionne mieux lorsqu’elle inclut des éléments de surprise pour le public comme pour l’artiste.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l’exposition « My Joburg » ?
Je ne peux pas vous en dire plus que ce que j’en sais ! L’exposition n’a pas encore ouvert et je vais orienter mon travail pour qu’il réponde à l’exposition, à mesure que je la découvre. Je suis conscient du fait qu’il y a cinquante artistes dans l’exposition, et donc cinquante perspectives. Je pense que ce sera une occasion unique de comprendre quelque chose de Johannesburg, de l’Afrique du Sud et de ses artistes… On pourra observer la ville de l’intérieur parce que les artistes locaux nous prêteront leurs yeux. Qu’est-ce que l’on verra ? En bien, je ne sais pas trop à quoi cela ressemblera jusqu’à cela arrive – comme dans la vie.
Quelles idées, quels sentiments ont accompagné votre travail sur ce projet ?
Il y a deux réponses à cette question, tout comme il y a deux sphincters, l’un externe et volontaire, l’autre interne et involontaire. À un niveau superficiel, lorsque je travaillais sur cette œuvre, mon idée était de créer quelque chose de courageux, de nouveau et de monumental… Mais j’avais aussi l’impression que les choses ne se passeraient pas comme ça. Mon idée est de tâter l’eau plutôt que de me noyer dans un sentiment d’hydrophobie. À un niveau interne, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis terrifié et je dois moi-même m’empêcher de m’arrêter.
Comment décririez-vous votre rapport à Johannesburg aujourd’hui, ville qui est désormais loin de vous, même si vous y retournez fréquemment. Comment voyez-vous l’évolution de votre ville à distance, et comment cela a-t’il influencé Sphincterography ?
D’un point de vue métaphorique, comment peut-on retourner dans la chambre dans laquelle on a grandi quand vos parents sont morts et que votre maison a été démolie ? Ma relation avec Johannesburg ressemble à n’importe quelle vraie relation d’amour et de perte… La découverte, l’enrichissement, la trahison et la réparation. Tout ce que je sais de moi s’est formulé à Johannesburg, et mes expériences plus tardives ont été comme filtrées par ces premières découvertes de moi-même. Quand je reviens à Johannesburg, c’est avec une conscience plus aiguë et une acceptation profonde du changement. Toute vibrante qu’elle soit, Johannesburg est aussi un lieu de mort subite ; lorsque je rentre, c’est toujours fortifiant de voir que si tout le monde est de plus en plus mal, tout le monde est aussi de plus en plus déterminé à survivre… Et ce sont ces présents de Johannesburg que j’apporte ensuite dans mon travail.
Qu’avez-vous ressenti en revisitant certaines de vos œuvres plus anciennes ? Votre opinion sur elles ou sur votre parcours a-t-elle changé ? Avez-vous réinterprété ces œuvres d’une façon ou d’une autre ?
Quand je regarde des œuvres passées, en particulier celles que j’ai négligées et que j’ai laissées mourir (c’est-à-dire celles que je n’ai jamais montées ou présentées auparavant), je suis obligé de les réévaluer sans les juger. C’est difficile d’avancer tout en regardant en arrière, possible mais précaire, parce que cela implique d’aller dans deux directions différentes en même temps, ce qui est intéressant mais impossible à maintenir très longtemps…
Je pense que quand les artistes choisissent une voie de développement artistique en dehors d’un système de succès et de reconnaissance officielle, c’est souvent à la fois bénéfique et destructeur.
Le corps joue, à l’évidence, un rôle essentiel dans votre travail. Avez-vous travaillé votre corps d’une façon particulière pour ce projet ? Pensez-vous au corps en termes de déterminations sociales, ethniques ou autres, par opposition à des transformations ou à des constructions alternatives de soi ?
Je cherche simplement à ralentir cette danse inévitable avec l’épuisement, la dépression et la mort… Un processus à écoulement lent, comme la lave refroidit et change de forme. Je vise à orienter le reste de ma vitalité, non pas sagement mais radicalement, vers le changement. Je veux être un vertébré enthousiaste, pas une vieille chose mollassonne. C’est difficile parce que, comme toujours, je ne laisse pas l’œuvre émerger de moi, je l’arrache. Il y a donc toujours des dommages, et ils s’accumulent.
Les thèmes de l’intimité, de l’autobiographie, et de l’exhibition, jouent aussi un rôle important dans votre travail. Comment pensez-vous ces questions ? Diriez-vous que l’on peut être d’autant plus politique que l’on explore la sphère intime ?
Les thèmes de l’intimité et de l’autobiographie, et la question de comment les exposer, constituent l’œuvre – en particulier en ce qui concerne l’intervention du public, dont je dois nécessairement taire ici les particularités. L’intervention du public est le pivot de l’œuvre que je présenterai dans la galerie. Comme avec ce type d’œuvres, l’intervention du public ne sera pas annoncée, et il y a donc une zone de flou dans le projet parce qu’une partie va se produire en public, hors la sphère de la galerie. Je m’invite à travailler en public, et cela fait des années que je n’ai pas étendu cette invitation à ma propre personne. Je réalise cette performance artistique, cette intervention publique comme une donation non sollicitée à la saison sud-africaine en France. Dans mon livre, taire les choses signifie mentir, et j’aimerais donc parler de la façon dont on peut transformer un espace public banal en un lieu de résistance, des périls du nationalisme et des difficultés du déplacement culturel. En lien avec tout cela, il y a des questions d’appartenance et de rejet. Les questions principales que je pose sont les suivantes : comment négocie-t-on notre citoyenneté sexuelle et quelles sont les options qui nous sont ouvertes, en tant qu’individus queer, pour pratiquer un art radical en dehors des espaces autorisés ?
Quel est le rôle de l’humour et de l’ironie dans ce travail, et dans votre pratique plus généralement ? Diriez-vous que votre titre vise à démythifier les conventions d’un art élevé ?
L’art élevé contemporain est obligatoirement auto-démythifiant – c’est une des conventions actuelles, cette façon de « défaire ». Je ne cherche pas à démythifier quoi que ce soit. Je cherche simplement à négocier la politique complexe de l’anus au moyen de l’art.
Le titre, Sphincterography (que je pensais avoir inventé, mais dont j’ai découvert qu’il existait déjà pour qualifier un geste médical impliquant un ballon), est précisé par son sous-titre, « la politique d’un trou du cul ». L’œuvre cherche à explorer la géographie culturelle du canal alimentaire, et les résonances politiques de sa chorégraphie. Si j’étais prétentieux, j’aurais appelé cette œuvre « sphinctérologie », ce qui aurait impliqué une branche plus crédible d’apprentissage, presque scientifique, connaissable. Mais il est clair pour moi que Sphincterography est un terme plus adéquat pour parler de la représentation d’un élément précis, et de l’art de décrire sa signification. L’ironie et l’humour sont présents dans tout ce que je fais, mais je m’efforce – et c’est parfois difficile – de leur donner forme sans pour autant être « cynique » ou « amusant ». Toute l’habileté réside dans la façon de les mélanger, comme du maquillage dont les composants sont indiscernables. J’essaye d’être stupide de façon maligne, si vous voulez. L’anus est un fragment du corps chargé et hautement légiféré. Il est clair pour moi que les orifices corporels sont liés à des lois – que certaines choses ne peuvent pas être dites (la bouche), vues (les yeux), entendues (les oreilles) ou faites (les parties génitales) … Mais l’anus est associé à une menace toute particulière. Personne ne se préoccupe de ce que vous faites avec votre coude. Oui, je crois que l’intimité est politique, mais seulement quand elle est rendue publique. C’est seulement à ce moment-là que les droits et les règles, le contrôle et le pouvoir, ou la mise en cause des systèmes, interviennent. D’après moi, il n’y a pas de politique dans la sphère privée ou dans la passivité. Mon art implique de créer des relations non contractuelles (et souvent conflictuelles) avec des individus ou des groupes, ou avec les structures de l’autorité qui essayent de les (et de me) contrôler.
Il est donc tout à fait stratégique pour moi de travailler en public sans y être invité. Je suis intéressé par des performances artistiques conçues dans la sphère privée puis exécutées dans l’espace public, au bon moment et dans le bon contexte ; des œuvres fortes mais éphémères qui sont solidement accrochées dans les airs.
Vous avez déclaré qu’en Afrique du Sud, l’espace, voire l’action la plus ordinaire, pouvait être politique. Qu’est-ce que cela signifie d’être politique pour un artiste sud-africain en France ? Est-ce différent qu’en Afrique du Sud ? La réception de votre travail, de la part du public ou des médias, est-elle également différente en France que dans votre pays ?
En tant qu’artiste sud-africain résidant et travaillant en France, ma simple présence est déjà politique. En Afrique du Sud, je suis blanc et en France je suis blanc sombre. Je ne me sens pas appartenir à la classe dirigeante, et je ne me sens pas non plus particulièrement le bienvenu, dans aucun des deux pays. En France, une partie de mon propos artistique est perdu parce qu’il s’exprime dans un dialecte étranger – visuellement, je parle le Sud-Africain. Je pense que les gens en France s’attendent à voir leurs artistes exotiques se comporter de façon exotique, tandis qu’en Afrique du Sud, on me considère seulement comme quelqu’un du coin qui a de mauvaises manières et qui exprime ses pathologies. Il y a aussi un langage particulier du commerce de la culture en France… Et si vous ne le maîtrisez pas, les gens ont du mal à vous comprendre. Dans les médias français, on me place toujours dans la rubrique « arts » tandis qu’en Afrique du Sud, j’arrive en général, par mes interventions publiques, à tirer les arts vers la rubrique des « nouvelles ». Je ne sais pas honnêtement si j’ai la réponse à ces questions, mais je suis sûr que nous en trouverons certaines ensemble en septembre.
Propos recueillis par Barbara Turquier, Festival d’Automne à Paris, 2013
Production : Cie Steven Cohen
Conférencier : Steven Cohen
COMPAGNIE STEVEN COHEN
24 rue Succursale | 33000 Bordeaux | France
Samuel Mateu
Administrateur de production | +33(0)6.27.72.32.88
production[@]steven-cohen.com
[EXHIBITION] STEVEN COHEN: LONG LIFE, Opening 11 December 2025, Iziko Museums of South Africa
[Photo reportage] on the highlights of Festival À Corps, in Poitiers.
[PROCHAINES DATES] iBall et Sphincterography en avril à Poitiers