Festival d’Avignon 2012
12 juillet 2012, par Renan Benyamina
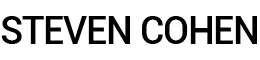

12 juillet 2012, par Renan Benyamina
Du lustre de votre performance, Chandelier, aux crânes sur lesquels vous marchiez dans Golgotha, les objets ont toujours été au cœur de vos créations, voire à leur origine. Pouvez-vous nous raconter l’histoire du journal intime qui est à la base de votre nouveau spectacle ?
Je suis moins intéressé par les objets en tant que tels, que par l’énergie et les histoires qui en émanent. Les objets sont des formes dans lesquelles je cherche des concepts. Pour des raisons légales, je ne peux pas répondre à votre question dans le détail. Mais je peux certainement dire des choses sur les choses que je ne peux pas dire. L’histoire inscrite dans ce journal intime n’est pas la mienne, mais le récit construit autour de cette histoire m’appartient.
Vous avez déjà traité le thème de l’Holocauste, dans Cleaning Time Vienna, ou pendant votre performance pour le Musée de la résistance à Lyon. Comment l’abordez-vous cette fois-ci ? Dans quelle mesure ce journal intime, tenu par un jeune Juif français entre 1939 et 1942, apporte-t-il quelque chose de nouveau ?
Il n’y a peut-être rien de nouveau dans ce matériau. Cependant, il est précieux parce qu’il est authentique, inédit et, surtout, parce qu’il a été écrit à l’époque de la Shoah et n’a jamais été retravaillé depuis. Même s’il n’apporte pas de nouvelles informations, il constitue un nouveau témoignage de cette période de l’Histoire. Cet objet trouvé nous ramène à l’histoire de l’Holocauste – à une histoire qui est presque entièrement régie par le désespoir, la destruction et l’anéantissement –, il est un signe d’optimisme, qui peut créer de l’énergie. L’auteur du journal n’a jamais cessé d’espérer (même l’action d’écrire un journal est un geste d’espoir), alors même que tous les systèmes de croyance autour de lui faisaient l’objet d’une destruction massive. Pour moi, ce journal parle des moments de soulagement, entre deux épisodes d’une insoutenable agonie ; il est une bouffée d’espoir avant le prochain étranglement, avec sa jubilation délicate pour la musique, la littérature et pour le simple fait d’être en vie. Pour moi, le journal incarne le dévouement et la confiance face à la destruction de tous les systèmes de croyance ; il est intelligent, sensible et pictural – mais surtout, il est le fruit de l’amour. Ce journal intime est une entité constante, dans un monde qui se désagrège. Au début, lorsque j’ai commencé à travailler avec ce journal, j’avais l’impression que je découvrais des choses qui n’appartenaient pas à la réalité de notre époque, des choses historiques. Maintenant que nous avons découvert les héritiers du journal (dont j’ai retrouvé moi-même la trace, et non l’inverse), j’ai le sentiment d’avoir pris quelque chose à des gens qui avaient déjà été contraints de donner beaucoup. La tournure que ce travail a pris m’a obligé à questionner, à réévaluer et à reconsidérer beaucoup de choses : l’histoire de l’Holocauste est si récente et si ancrée dans notre présent, que chaque morceau de papier provenant de cette période de l’Histoire porte la trace de son propriétaire, une personne en chair et en os avec une existence bien tangible… Ce ne sont pas de simples récits, mais les témoins de vies bien réelles.
Une des caractéristiques fondamentales de votre travail est de faire des allers-retours entre deux réalités : votre histoire personnelle et celle du monde. Quelles passerelles établissez-vous entre le journal intime de ce jeune homme et vous-même ?
Je tiens moi aussi un journal, dans lequel j’écris les choses que je ne parviens pas à dire, et les choses qui ne doivent pas être dites. Mais le journal intime que j’ai trouvé et qui sert de point de départ au spectacle est en quelque sorte le journal que je n’ai pas eu à écrire, car mes grands parents ont échappé aux circonstances qui y sont décrites. En tant qu’artiste visuel, je me suis immédiatement attaché aux illustrations qui composent le journal, plutôt qu’à la langue, qui m’était totalement étrangère lorsque j’ai découvert l’objet. Mais l’écho que je perçois dans cet objet trouvé provient étonnamment autant de sa forme que de son contenu – la multitude de petits textes et leurs illustrations, méthodiques, minutieuses et miniatures –, et du fait qu’une scène soit exprimée dans un centimètre carré, avec une économie de mots et de traits. Les observations consignées dans ce journal sont d’une innocence hautement intelligente. On y dénote une certaine naïveté, mais aussi une fervente volonté de vivre, à travers ses efforts inlassables de consigner ce qui arrive et les descriptions banales qui attestent de l’effroyable piège – remarquablement orchestré – qui s’abat sur les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Votre travail est marqué par des occupations dérangeantes de l’espace public (les townships, Wall Street, etc.). Avec Title Withheld, vous nous invitez cette fois-ci sous la scène de la Cour d’honneur du Palais des papes…
Il y a une curieuse contradiction à inviter les spectateurs dans un espace dont l’accès leur est généralement interdit. C’est un lieu particulièrement intéressant pour montrer le processus de création plutôt que le résultat abouti. Pour moi, travailler dans cet espace est une chance pour expérimenter et laisser le public voir ce qui se passe derrière la façade, depuis l’intérieur du sac qui contient les tours du magicien, et observer les fils qui tissent ensemble l’illusion. C’est aussi un endroit où l’on peut se raconter des secrets. Ce n’est pas une réalité parallèle, mais un autre point de vue sur cette même réalité. Sous la théâtralité du plateau, on entrevoit les fondements qui révèlent la nature de ce qu’ils supportent. L’espace physique des dessous de scène évoque de nombreuses questions : que signifie vivre du mauvais côté de la frontière, derrière le mur, dans une zone de non-droit, caché ? Comment pouvons-nous comprendre avec empathie ce que signifie vivre avec de faux papiers, emprunter une identité, vivre sous un déguisement, avec une protection illusoire, enfermé dans des placards ? Nous pouvons le comprendre, car nous vivons tous avec des mensonges… le genre de mensonge que la mort révèle… ou bien la vie. J’ignore à quel point l’espace va redéfinir mon travail, s’il va amplifier, déformer ou faire résonner différemment mes intentions. Je dois travailler sans aucune certitude, mais avec beaucoup de confiance. Personnellement, évoluer sous le plateau me libère des attentes relatives à ce qui se passe habituellement sur la scène. Je n’essaie pas de recréer un spectacle à l’envers, une ombre de la réalité.
Que va-t-il alors se passer dans ses dessous de scène ?
Je ne peux pas vous donner de réponse à cette question. Non que je souhaite vous cacher quelque chose, non, je suis honnête quand je vous dis que ce qui va se passer est une surprise pour nous tous, y compris pour moi. Bien sûr, il y a des éléments avec lesquels j’ai volontairement choisi de travailler, mais la manière dont ils vont interagir et dont ils vont se présenter ensemble, je n’en ai aucune idée. C’est comme cuisiner sans recette. Il y a une multitude de choses que je voudrais utiliser, mais je ne peux pas (parce qu’elles sont illégales, coûteuses ou impossibles), de sorte que mon travail sera forcément empreint de ce qui n’a pu être utilisé. Du manqué éprouvé et de mes trouvailles. Mon travail ne parlera pas de moments en particulier, mais du temps qui se niche entre ces moments, acceptant la perte, intégrant la découverte, et restant ouvert à la possibilité de tout perdre à nouveau. Le travail a eu raison de moi – je suis obligé de retrouver du sens dans le fait d’être l’objet de ma propre création –, ce qui est aussi insensé que la vie, je sais, mais il y a des moments où je préfère le sensible au raisonnable, et parfois, je pense que le non-sens a plus de signification que la logique froide et implacable. Je veux rester ouvert aux circonstances troublantes que le fait d’être sous la scène pourrait impliquer. Je n’ambitionne pas d’être un conquérant tout-puissant, qui peut transformer chaque espace en allant à l’encontre de sa nature. Nous, artiste et spectateur, moi et vous, avons la chance d’être autorisés à passer du temps ensemble dans cet espace. Nous nous réjouirons en ce lieu, même s’il ne nous est pas très plaisant.
Vous vous qualifiez de « Juif antisioniste ». Ce positionnement identitaire a-t-il des implications dans votre pièce ?
Il est trop facile d’interpréter à tort le slogan « Juif antisioniste ». Je préfère me décrire comme un Juif qui a d’énormes problèmes avec les réalités politiques et les pratiques sionistes de l’État d’Israël. Mais dans mes recherches pour cette création à Avignon, j’ai pris la décision personnelle de ne pas utiliser l’Holocauste comme un fer de lance contre le sionisme en Israël. C’était mon intention initiale, mais mes intentions ont changé, tout comme l’eau bouillante se change en vapeur d’eau. J’ai grandi dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, dans un système familial qui était aussi raciste que l’encourageait l’État. J’ai grandi sans me poser de questions et sans mener d’actions : je me considère donc comme complice de ce système de discrimination – les discriminations précèdent toujours les génocides – reconnu comme un crime contre l’humanité. Mes grands-parents (que j’aimais intensément et à qui je pardonnais tout) ont échappé à un système raciste, qui débuta avec la répression et la discrimination, et se termina par l’extermination de diverses communautés d’Europe de l’Est. Mais en venant en Afrique du Sud, ils sont devenus ce qu’ils méprisaient, c’est-à-dire des oppresseurs culturellement dominants qui ont tiré profit d’un système politique injuste. Pour moi, c’est une meilleure base pour attaquer les politiques sionistes. Après avoir vécu dans le système de l’apartheid en Afrique du Sud, certains Juifs, auparavant considérés en Europe comme de méprisables nègres blancs, sont devenus de grands patrons tout-puissants, écrasant une population noire asservie et impuissante. Mais ceci fera l’objet d’un autre travail. Ce sera pour mon prochain projet que j’ai déjà intitulé – non sans autocritique –, « Je suis AshkeNazi ».
Pendant le processus de création, vous avez sollicité plusieurs institutions comme le musée de l’Holocauste du Cap. Quel a été l’apport de ces rencontres ?
Pour moi, il était important de pouvoir effectuer des recherches au Centre sur l’Holocauste au Cap, en Afrique du Sud, car le musée a une approche globale de l’histoire de la Shoah, ainsi que des autres systèmes d’oppression et de discrimination qui ont résulté de ce génocide. Verrons-nous les résultats de cette recherche sur scène ? Probablement pas. Mais les informations glanées pendant cette phase ont nourri mon travail dans son ensemble. Elles ont changé sa nature et même son état – les intentions vaporeuses se sont matérialisées en de solides convictions. Ce besoin de faire de telles recherches tient aussi au fait qu’être un Juif blanc en Afrique du Sud est une position compliquée et délicate (à la fois de victime et de vainqueur). Il m’a semblé nécessaire de fonder une partie de mes recherches au sein du pays où mes grands-parents ont fui et dans lequel ils ont trouvé une voie complexe de salut. Parfois, au fil de mes recherches, dans une image ou dans une vitrine d’exposition, je trouve un élément que je peux traduire sous la forme d’un costume ou d’une action, et rendre, en un sens, lisible à travers la performance que je vais créer. Au Centre sur l’Holocauste du Cap, j’ai été frappé par une image en particulier, celle d’un groupe de préadolescentes juives victimes d’expériences de brûlure. Jeunes et sévèrement (mortellement) abusées, à l’article de la mort mais toujours atrocement vivantes, elles regardent l’objectif avec une lueur d’espoir, adoptant la pose la plus gracieuse qu’elles puissent, torturées et couvertes par la crasse, les jambes croisées délicatement. C’est une image qui me hante. Sera-t-elle dans mon travail ? Non, mais elle sera en moi, et je serai dans mon travail.
Dans Title Withheld, vous serez seul en scène. Par quels moyens convoquerez-vous toutes les figures que vous souhaitez mettre en lumière ?
Je ne serai pas sur la scène, la scène sera en moi. Il se pourrait effectivement que je sois la seule personne présente pendant le spectacle, mais je ne serai jamais seul. Je suis beaucoup trop hanté pour cela…
Allez-vous représenter sur scène les dessins qui constituent près de la moitié du journal du jeune Juif que vous avez retrouvé et qui constitue la source d’inspiration de Title Withheld ?
J’ai toujours voulu représenter ces illustrations sur scène, d’une manière fragile et éphémère, comme une série de représentations projetées dans l’air, temporaires et flottantes, en perpétuelle transformation. Ce projet est peut-être devenu une chimère à présent, en raison des complications juridiques qui sont survenues suite à l’identification des descendants de ce jeune Juif. Si je voulais faire connaître cette œuvre artistique, inédite et précieuse, je souhaitais également découvrir l’histoire de son auteur… J’ai donc effectué des recherches infructueuses dans les registres de la déportation (avec l’aide d’un expert archiviste) qui ne m’ont fourni aucun indice. Ce n’est qu’en explorant les cahiers avec l’aide énergique, active et impitoyablement efficace d’Agathe Berman et en examinant tous les détails et indices des cahiers, que nous avons réussi à trouver la famille de l’auteur et à communiquer avec eux. Pour moi, cette «marche du feu » était nécessaire. Ce que je pensais jusqu’ici être mon histoire est soudain devenu une histoire appartenant à quelqu’un d’autre.
Qu’est-il important pour vous de créer dans l’esprit des spectateurs : un geste de mémoire ?
Pour moi, il est important de créer dans l’esprit des spectateurs des réponses simultanées et contradictoires… Un état de conscience tout aussi inconfortable que prolifique, une tension propice à la découverte de soi, périlleuse mais extrêmement enrichissante.
Le titre de la seconde pièce que vous présentez au Festival d’Avignon, The Cradle of Humankind, peut être lu de deux façons. Il signifie littéralement « berceau de l’humanité » et désigne aussi un site archéologique près de Johannesburg, dans votre pays natal. Vous avez visité ce site : qu’y avez-vous ressenti et qu’est-ce qui vous a donné envie d’en tirer une pièce ?
The Cradle of Humankind est un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, situé à quarante minutes de Johannesburg, dont la signification paléoanthropologique supplante l’intérêt archéologique. Il s’agit d’un site familier pour tous les SudAfricains, qui fait partie intégrante de tous les voyages scolaires. Aussi, ma découverte du site remonte-t-elle à mon plus jeune âge et constitue-t-elle un élément fondateur de mon parcours. Ces grottes témoignent du fait que le premier homme savait marcher debout (avant même de devenir bipède), et qu’il a appris à exploiter et maîtriser le feu (ce qui a bouleversé notre évolution de manière fondamentale). Je voulais explorer l’idée que la marche a abouti à la danse ; que l’utilisation du feu a amené à contrôler la lumière et que l’art rupestre a évolué vers la performance ou encore le body art… Ces grottes constituent les premiers opéras sur notre condition humaine. Avec The Cradle of Humankind, j’ai tenté de créer une œuvre qui opère une fusion entre l’art et la science, sans pour autant devenir prisonnier d’un dogme de l’une ou l’autre de ces disciplines.
Vous avez été autorisé à tourner sur le site…
Nous avons demandé l’appui de diverses autorités et des pouvoirs publics (le gouvernement provincial sud-africain, Maropeng iAfrika, l’Université de Witwatersrand) pour réaliser ce spectacle, mais il a fallu beaucoup de temps et de nombreuses et subtiles négociations pour être en capacité de réaliser une performance (et de la filmer) dans ces sites protégés… Une première pour l’art de la performance en Afrique du Sud. Bien que nous ayons déjà filmé dans des grottes plus spectaculaires, mais moins intéressantes sur le plan scientifique, l’expérience de travail dans Sterkfontein et Swartkrans a été très différente. Nomsa et moi étions très intimidés (et c’est peut-être visible dans la vidéo de la performance), à fleur de peau mais profondément solennels. Nous étions traversés par l’importance de ce que nous faisions. Ce fut une expérience sublime, inoubliable, qui nous a profondément bouleversés. J’ai remarqué dans mes recherches sur les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco que de nombreux sites en France et en Europe, historiques, architecturaux ou archéologiques, sont souvent le produit de la main de l’Homme. En Afrique du Sud, les quelques sites que nous avons sont en grande partie naturels. À mon avis, il y a une différence notable entre l’Europe (où l’Homme a créé Dieu) et l’Afrique (où Dieu a créé l’Homme). The Cradle of Humankind est aussi extrêmement important, car il montre que toute vie provient de l’Afrique. Comme le dit Nomsa avec concision : « Même si tu es blanc, blanc, blanc – tu es noir. »
En quoi la présence de votre ancienne nourrice, Nomsa Dhlamini, avec vous sur scène, est-elle importante ? Pourquoi pensez-vous qu’elle ait un rôle à jouer dans ce spectacle sur l’Afrique du Sud et sur les origines du monde ?
L’importance de Nomsa tient au fait qu’elle ne joue pas. Elle ne se produit pas sur scène, ni ne feint de se produire. Elle est simplement présente, avec tant d’intégrité que cela en devient immaculé et donc troublant. J’avais besoin de quelqu’un qui apporte à mon travail à la fois l’apparence et la sagesse d’une personne âgée de trois millions d’années. Seule Nomsa pouvait le faire. Dans The Cradle of Humankind, j’ai l’impression d’être sur scène avec Nomsa plutôt que l’inverse. Pour moi, Nomsa a été créée et façonnée selon les lois de la perfection universelle. The Cradle of Humankind se veut à la fois poétique et scientifique, tout en échappant à ces deux domaines. C’est un travail sur les origines de notre espèce, mais aussi une œuvre qui regarde de l’avant. Elle parle de l’évolution, de l’adaptation au milieu, de la survie, mais aussi et par-dessus tout, de l’acte d’amour et de la façon de retrouver du sens et de la joie après qu’ils aient été anéantis et oubliés.
Propos recueillis par Renan Benyamina. Traduction Clara Canis.
Conception, costumes et accessoires Steven Cohen
Dramaturgie Agathe Berman
Lumière Erik Houllier
Son et vidéo Armando Menicacci
Dresseur animalier Guy Demazure
Production Latitudes Prod (Lille)
Coproduction Festival d’Avignon, BIT Teatergarasjen (Bergen), Latitudes Contemporaines (Lille), NEXT Festival Eurometropolis (Lille-Kortrijk-Tournai-Valenciennes-FR/B), La Bâtie Festival de Genève
Avec le soutien de la Ville de Lille et le programme Lille Ville d’Arts du futur, de la DRAC Nord-Pas de Calais, de la Région Nord-Pas de Calais, de l’Institut français, du projet Transdigital (FEDER/Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen) et de Lille 3000 Fantastic
COMPAGNIE STEVEN COHEN
24 rue Succursale | 33000 Bordeaux | France
Samuel Mateu
Administrateur de production | +33(0)6.27.72.32.88
production[@]steven-cohen.com
Chorégraphie, Conception, scénographie et costumes : Steven Cohen
Interprétation : Nomsa Dhlamini, Steven Cohen
Création lumière et direction technique : Erik Houllier
Régie vidéo : Baptiste Evrard
Réalisation costumes : Léa Drouault
Assistant à la création : Elu Kieser.
Production Latitudes Prod (Lille)
Coproductions Le Quartz Scène nationale de Brest, Les Spectacles Vivants-Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne à Paris, Le phénix Scène nationale de Valenciennes, La Bâtie Festival de Genève, Théâtre Garonne (Toulouse), Le Manège.mons/CECN (Transdigital), Technocité (Mons), Réseau Open Latitudes avec le soutien du programme Culture de l’Union européenne
Avec le soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord-Pas de Calais, de la Région Nord-Pas de Calais, de Lille Métropole-Communauté urbaine, de l’Institut français, du DICREAM, du CRRAV (Centre Régional de Ressources Audiovisuelles) de Tourcoing et du Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing, dans le cadre de Transdigital (FEDER/Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen)
Cette création est dédiée à la mémoire de Merrill Plagis
[EXHIBITION] STEVEN COHEN: LONG LIFE, Opening 11 December 2025, Iziko Museums of South Africa
[PRESSE] Toutelaculture.com, 28 novembre 2012, par Audrey Chaix
[PRESSE] LesTroisCoups.com, 21 juillet 2012, par Aurore Krol
[PRESSE] Le Monde, 13 juillet 2012, par Rosita Boisseau (Avignon, envoyée spéciale)
[PRESSE] ParisArt, 7 novembre 2011, par Smaranda Olcèse-Trifan.